Daniel ARANJO
TOUT-TERRAIN
SAHARA
FRONTIÈRE
ALGÉRIE/NIGER
ÉTUDE
SPATIALE
Prix de la Critique 2003 de
l’Académie
française, est aussi poète et dramaturge (un
texte créé tous les ans par le
Théâtre du Nord-Ouest, Paris IXe :
Un Requiem en français ;
Agamemnon, Atlantica éd. ; Les
Choéphores ; Dies iræ
en
2008). Poèmes disponibles sur quelques sites Internet, en
particulier étrangers
(Babelmed/Trans-ports).
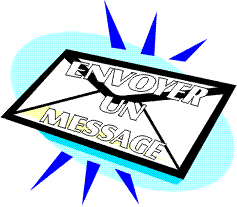 contact
contact
SAHARA,
été 1976
Mon
premier contact, pas banal, avec l'Algérie fut In
Guezzam, l'été 1976, alors que je remontais, avec
rudesse, du Centrafrique en
Land Rover à double débrayage, lèvres
gercées par l'air depuis l'Aïr, chech
targui pour tout bâillon, parce que sans pare-brise (et que
celui que nous avions
trouvé dans une casse à Agadès,
même fourbi au gasoil, restait trop sale, et
lacéré comme une tempête à
coup de cailloux ou de gros sable à essuie-glace).
Et c'est vraiment quelque chose de considérable que de
découvrir enfin le Nord
fertile, sa façade maritime, ses ruines romaines,
après être longuement, et
périlleusement venu du Sable absolu, avec sa piste non
tracée, ses
balises-bidons de sable avec un pieu fiché dedans (deux
jusqu'à l'horizon, une
parfois seulement) et son trafic réduit à un seul
véhicule-jour - sautant
sans trop dévier de cercle brun en cercle brun
(là
où le sable est ferme et caillouteux) à travers
l'étendue jaune ou blanche où
l'on s'enlise vite et peine à progresser.
*
Entre Rien et Tout. Sur le toit sableux du
monde. Et nous dûmes
revenir sur nos traces au poste nigérien, parce que perdus ;
et que nous avions
mal compris le chemin indiqué par les douaniers d'Assamaka.
Nous avions pris
trop vite à droite. Et comme nous ne voyions toujours pas la
moindre balise,
avions fini par rebrousser chemin et retrouver avec quelque joie le
seul arbre
(grand épineux), toujours entre rien et tout, que nous ayons
aperçu à l'aller à
travers la poudre-gravier entre Nord-Niger (le sable, ce fluide verglas
sous
les coups de volant, est aussi terrifiant que la neige), et
Sud-Sud-Algérien
(où ? pour l'heure, la route, c'est la volonté
tenace et butée de notre vieille
Land qui mâche, mâche le sable, après
avoir mâché la tôle
trépidante et ondulée
du Sahel sous la mitraille des essieux). Sainte ferraille ! Tienne la
mécanique. Elle tient, tient encore ; le moteur tourne,
tourne à peine ; comme
nous. Parlons peu. Conduisons à tour de rôle.
Assamaka, c'est cette image : un
muret de pierraille autour d'un pré de sable, où
doivent paître les quelques
chèvres de la garnison. Nous y revenons. Être
partis à jamais d'ici ; et y
revenir. Les douaniers avaient vu notre erreur. Et auraient fait des
recherches, si nous n'étions pas revenus. Combien de
kilomètres entre Assamaka
et In Guezzam ? Un demi-jerrican d'essence ? La quantité
d'essence, voilà
encore le meilleur étalon, en tout ce vide et tout cela.
Silence. Absence.
Moteur. Brouillard plâtreux. N'y même pas penser.
Vent de neige à souffle
d'avalanche au ras du sol sans sol. Un burnous, là-dedans,
semblerait lutter
contre l'hiver. Or combien fera-t-il, par ici, à deux heures
de l'après-midi ?
Ne pas parler de solitude, ni du danger. C'est au repos qu'on y pense
surtout.
On s'arrête, mais le paysage (ou ce qu'il en reste) ne
s'arrête pas, et fuit
rejoindre l'horizon quelque temps. Fatigue, faille : qu'est-on venu
faire ici ?
Ici, pour l'heure, c'est quelques
arpents de sable presque blanc. Pourquoi ceux-ci plutôt que
d'autres,
pauvrement et éternellement semblables et
différents ? C'était donc ça, le
Sahara ? Une épreuve de conduite…
l'épreuve pâle et tuante du présent au
regard
de l'attente infinie. Sortir d'ici !
*
Avant Tamanrasset.
Il va pleuvoir. Il
repleut après trois ans. Odeur fertile d'ozone, que j'ai du
mal à identifier,
parce que je la sens pour la première fois de ma vie, monter
du sable immense
et roux. Didier, l'autre conducteur, me dit que cette odeur dense et
tiède que
je cherche à cerner depuis l'horizon est assez
fréquente en Espagne sur
d'arrière-plages surchauffées, quand il y pleut
l'été. Un moteur de camion
tourne autour de nous depuis les horizons ; depuis un horizon, puis
depuis
l'autre. Non ce n'est pas l'écho de notre propre capot. Un
mirage sonore (oui,
c'est exactement cela), coincé sous la touffeur terreuse et
froide des nuages.
On s'enlise dans un fossé meuble d'eau, que l'on avait
sous-estimé et à peine
gardé, au fond de la rétine. Orage ocre et ras.
Le bruit de camion, toujours,
autour de nous, de loin, de près, de très
près, de loin à nouveau. On ne le
verra jamais.
*
Plus loin ; bien
plus loin. Échine
; et
sable du chemin de sable. Puis quelques pierres, ici et là,
qui se mettent à
border la piste. Quelques maisons de chaux ; et peut-être une
petite mosquée,
badigeonnée de poussière. Sacré
anonyme et objectif de l'espace ; tracé
initiatique et nu, mais entre quoi et quoi ? Continuer ; se sortir
d'ici, où
l'on est pourtant venu ; chercher quoi ?
*
Avant
Ghardaïa, peut-être. Oasis au
naturel, sans palme ni
palmeraie, par des
canicules de roc, où je n'aurai pas du moins à
rêver. Pas plus qu'on ne rêve,
sur tout le kilométrage aride d'Arlit, devant une mine
à ciel ouvert et à hauts
pneus et hautes bennes Caterpilar évasées
d'uranium - sous cette pièce de
monnaie usée, là-haut, à force de
poussière (soleil).
Brûlure
de la
course. Le Désert, Dieu sans les hommes? Je n'en aurai
jamais senti la moindre
fraîcheur.
Retour épisode 23
©
2007  | Feuilleton
|
| Feuilleton
| 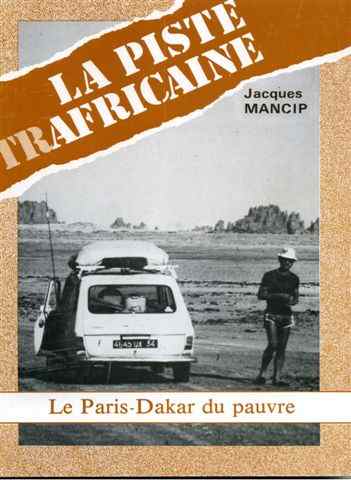 |
| 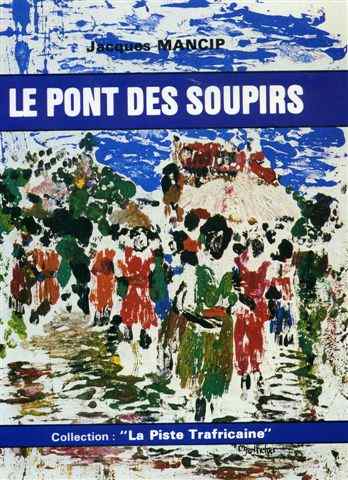 |
| 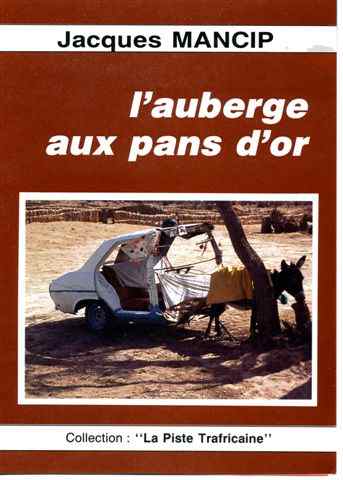 |
|
Pour commander un, deux ou trois
livres :




 | Feuilleton
|
| Feuilleton
| 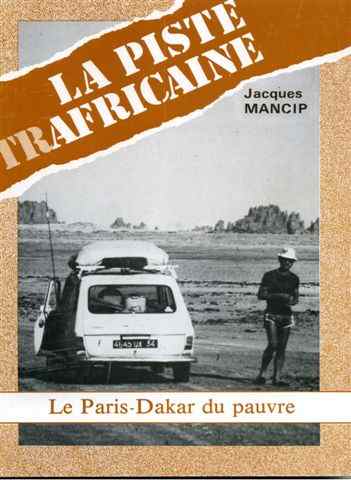 |
| 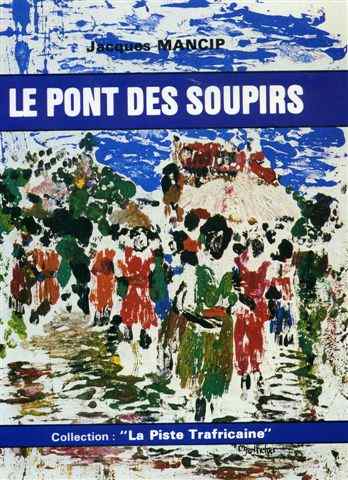 |
| 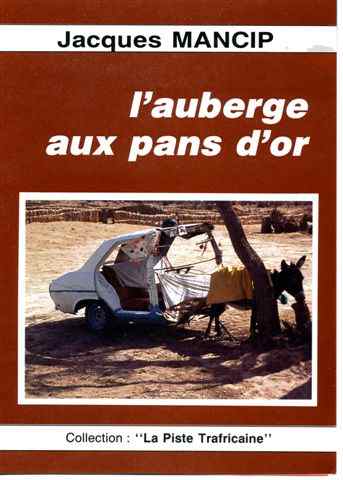 |
|